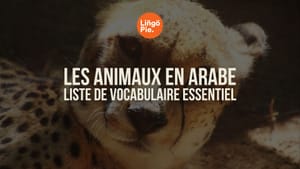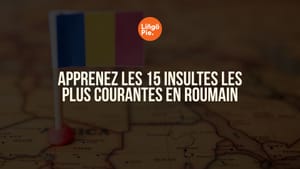Le québécois ? Certains disent que c’est une autre langue. D’autres jurent que c’est juste du français avec un accent chantant. Personnellement, lors de mon stage à Montréal, j’ai vite compris une chose : entre le français de France et le français québécois, les différences ne manquent pas ! Et pas seulement dans la prononciation… mais aussi dans les expressions, les mots du quotidien et même la façon de structurer certaines phrases.
Vous aussi, vous avez déjà entendu un "c’est écœurant" québécois et vous vous êtes demandé si c’était un compliment ou une insulte ? Vous ne savez pas quoi répondre à un "t’es-tu prêt ?" ? Alors vous êtes au bon endroit.
Dans cet article, je vous propose de découvrir les 25 différences les plus marquantes entre le français québécois et le français de France et de comprendre les subtilités de l’accent québécois. C'est parti !
- Célèbres Polyglottes : 8 Experts Qui Vont Vous Inspirer
- Comment dit-on bonjour en croate ? 7 salutations à connaître
- 11+ façons de dire bonjour en arabe

Le français québécois : ses origines et spécificités
Avant de comparer les mots et expressions, il faut remonter un peu dans le temps. Le français québécois n’est pas une simple variante du français, loin de là. C’est un héritage linguistique riche, façonné par l’histoire, la géographie et les contacts culturels.
Une langue venue de France… au XVIIe siècle
Un peu d'histoire : Quand les colons français s’installent en Nouvelle-France au 17e siècle, ils apportent avec eux leur français de l’époque : un mélange de dialectes régionaux (notamment de Normandie, de Bretagne, du Poitou…).
Ce français a ensuite évolué de façon indépendante en Amérique du Nord, à l’écart des évolutions linguistiques vécues en métropole.
Pendant ce temps, le français de France change, s’uniformise (notamment à Paris), tandis qu’au Québec, certains termes anciens sont restés… et d’autres sont apparus.
Un mélange influencé par l’anglais
Avec le temps, le français québécois s’est enrichi de mots d’origine anglaise (influences économiques, télé, politique, etc.), mais il a aussi développé ses propres tournures et expressions, souvent imagées et très expressives.
Et contrairement à ce qu’on pense souvent, le vocabulaire n’est pas “anglicisé”. Il existe au Québec une vraie volonté de préserver la langue française, notamment à travers l’Office québécois de la langue française. En France métropolitaine, de nombreux mots sont anglicisés, contrairement au Québec où l'on privilégie des termes français (ex: "arrêt" au lieu de "stop").
Une langue vivante, identitaire et assumée
Le français québécois, c’est aussi un marqueur culturel fort, un vrai vecteur d’identité. Il reflète une façon de penser, de vivre et de communiquer bien particulière.
On ne parle pas juste différemment, on pense et on exprime les choses autrement.
25 mots différents entre le français québécois et le français de France
Voici un petit tour des mots du quotidien qui ne signifient pas forcément la même chose des deux côtés de l’Atlantique.
| Québec | France | Traduction / usage |
|---|---|---|
| char | voiture | Un "char" au Québec, c’est tout simplement une voiture. |
| chum / blonde | petit ami / petite amie | Très courant au Québec : "Mon chum" = mon copain. |
| magasinage | shopping | "Faire du magasinage" = faire du shopping. |
| épicerie | supermarché | L’épicerie désigne le lieu où l’on fait ses courses. |
| dépanneur | supérette / petit commerce | Petite épicerie de quartier, souvent ouverte tard. |
| breuvage | boisson | Mot très courant au Québec, surtout dans les restos. |
| souliers | chaussures | "Souliers" est plus ancien, mais encore très utilisé. |
| tuque | bonnet | Un indispensable pour l’hiver québécois. |
| bas | chaussettes | Attention à la confusion : les "bas" = socks ! |
| gosses | testicules (!), enfants (FR) | Piège culturel : à éviter dans une conversation formelle. |
| sac de poubelle | sac-poubelle | Même chose, mais formulation différente. |
| cégep | lycée / prépa / BTS | Système d’enseignement post-secondaire propre au Québec. |
| linge | vêtements | "Ramasse ton linge !" = ramasse tes habits. |
| lavage | lessive / machine à laver | "Faire le lavage" = faire une machine. |
| party | fête / soirée | Usage très courant, même à l’oral. |
| s’enfarger | trébucher | Mot typiquement québécois, imagé. |
| barrer la porte | fermer à clé | "Barrer" = verrouiller, fermer. |
| placoter | bavarder, discuter | Expression très populaire. |
| pogner | attraper / marcher fort | Ex : "Ce film a pogné" = Ce film a bien marché. |
| niaiser | se moquer / perdre son temps | "Arrête de niaiser" = Arrête de faire l’idiot. |
| jaser | papoter, discuter | Très courant : "On va jaser un peu ?" |
| être tanné | en avoir marre | "Je suis tanné" = J’en ai assez. |
| avoir de la misère | avoir du mal à | "J’ai de la misère à comprendre" = J’ai du mal à comprendre. |
| pogner les nerfs | s’énerver | Ex : "Il a pogné les nerfs" = Il a pété un câble. |
| se faire passer un sapin | se faire avoir | Expression imagée pour dire qu’on s’est fait duper. |

Expressions uniques au français québécois
Le québécois ne se distingue pas seulement par ses mots : ce sont aussi des expressions imagées, souvent très différentes de celles qu’on utilise en France. Voici quelques-unes de mes favorites.
| Expression québécoise | Sens en français de France | Exemple ou explication |
|---|---|---|
| Se pogner le beigne | Ne rien faire, traîner | “Il fait rien de sa journée, il se pogne le beigne.” |
| Être aux oiseaux | Être très content | “Elle était aux oiseaux en recevant son cadeau.” |
| Avoir la chienne | Avoir très peur | “J’ai eu la chienne en regardant ce film d’horreur.” |
| Se tirer une bûche | Prendre une chaise | Littéralement : "Viens, tire-toi une bûche et assieds-toi." |
| C’est le fun | C’est sympa / agréable | “Ce resto-là, c’est vraiment le fun !” |
| Virer une brosse | Faire la fête, se saouler | “Ils ont viré une brosse hier soir.” |
| Capoter (positivement ou non) | Être très excité / paniquer | “Je capote sur cette série !” / “Il a capoté pour rien.” |
| Tomber en amour | Tomber amoureux | “Ils sont tombés en amour cet été.” |
| Avoir les yeux dans la graisse de bines | Être fatigué, avoir l’air vaseux | Une façon imagée de dire qu’on est à côté de la plaque ! |
| Attache ta tuque (avec d’la broche) | Prépare-toi, ça va secouer | “Attache ta tuque, l’hiver arrive !” |
| Donner un char de troubles | Créer des problèmes | “Lui, il fait juste donner un char de troubles.” |
| Être habillé comme la chienne à Jacques | Être mal habillé | Une image bien québécoise ! |
| Se faire passer un sapin | Se faire avoir, arnaquer | “Il s’est fait passer un sapin avec cette voiture.” |




![Le subjonctif en espagnol : tout ce qu'il faut savoir [2025]](/blog/content/images/2025/07/Le-subjonctif-en-espagnol.jpg)